GROUPES D'ÉTUDES THÉORIQUES
Contenu réductible
Logique du G.E.T.
Au rythme d'une fois par mois, une personnalité singulière par son œuvre, propose une communication suivie, sur une année.
Pour assister à ces groupes d'études théoriques, il vous suffit de devenir membre du Salon Tout-Art.
En devenant membre du Salon Tout-Art, vous aurez accès à l'ensemble des groupes d'études théoriques. Une séance de découverte vous est offerte.
Le Salon Tout-Art est une association à but non lucratif.
ANNÉE 2025 - 2026

Le mercredi de 20h à 21h30 : 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1, 5 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 juin 2026.
L'horreur de savoir - par Yorick Secretin
Dans sa Note italienne, Lacan nous dit que l’humanité n’est pas animée par un désir de savoir, mais bien plutôt par une « horreur de savoir » qui fonde tout sujet d’être de part en part concerné singulièrement par l’inconscient, le sien propre, qui le divise et le cause comme sujet humain, vivant et parlant — animé dès lors par un « n’en rien vouloir savoir » de sa vérité singulière, laquelle se voile, sous couvert d’universel, derrière de belles théories ou conceptions philosophiques du monde.
Ce groupe d’étude théorique se proposera ainsi comme réflexion critique, conceptuelle et historiographique, les effets de l’hypothèse d’existence de l’inconscient singulier — et de l’objet à sa cause — sur la vérité et le savoir, posant ainsi cette question cruciale pour la philosophie : L’existence de l’inconscient singulier, en ce qu’elle fait du sujet un être divisé, traversé par un « savoir insu à lui-même », constitue-t-elle la condition d’impossibilité de la vérité philosophique ? Et, ce faisant, à quel prix un sujet humain peut-il encore dire vrai ?

De 20h à 21h30, 14.10 / 18.11 / 16.12 / 20.01 / 17.02 / 17.03 / 14.04 / 19.05 / 16.06
La marche du Séminaire XI : systole du retour, diastole de l’inventivité par Karim Barkati
Le Séminaire XI de Jacques Lacan, prononcé en 1964, est tout sauf une simple porte d’entrée. C’est un moment de bascule : systole, contraction d’un long retour à Freud ; diastole, ouverture vers une nouvelle inventivité théorique et politique. Lacan interroge alors les fondements mêmes de la psychanalyse et marque un tournant décisif dans son enseignement. Nous lirons et discuterons les quatre concepts fondamentaux — inconscient, répétition, transfert, pulsion — mais aussi tout ce que ce texte laisse affleurer : praxis analytique, rapport au réel, articulation entre langage et séparation, bouleversement institutionnel. Le Séminaire XI condense et déplace, clôt et inaugure : un texte charnière où le « premier Lacan » s’achève et où le « second » s’invente. Ce groupe d’étude sera un lieu de lecture partagée et d’échanges, attentif à ce moment de rupture autant qu’à ses résonances pour notre présent.

De 17h à 18h30, 21/10, 09/12, 19/02, 07/04, 14/04, 05/05, 26/05 et 09/06
Le possible et le réel par Luz Ascarate
Il y a ce qui est, le poids du monde, et ce qui pourrait être : ce qui bruisse dans l’imaginaire, les rêves et les luttes. Entre les deux, l’impossible n’est peut-être que le réel en attente de passage.
Ce groupe d’étude théorique explorera les relations entre possible et réel, leurs résonances philosophiques, poétiques, politiques et musicales. Il s’agira d’interroger les puissances de l’imagination, du rêve et de l’utopie dans leur capacité à déplacer les contours du monde.
Ouvert à toutes et tous, il propose un espace de pensée et d’échanges sur les devenirs inattendus et les seuils entre ce qui est et ce qui pourrait être.

De 19h à 20h30, 07.10 / 04.11 / 10.12 / 27.01 / 10.03 / 05.05 / 02.06
Introduction à la pensée de Simone Weil par Alice Mennesson
Ce groupe d’études théoriques proposera un itinéraire dans la pensée de Simone Weil, des premiers écrits de khâgne à L’Enracinement. Comment approcher une œuvre si diverse dans ses formes et ses objets ? Quel lien entre l’élève d’Alain, la critique du colonialisme, le Journal d’usine, le projet d’infirmières de première ligne et les méditations ultimes sur le malheur et l’amour de Dieu ? À travers quelques textes majeurs, il s’agira de suivre une pensée à la fois engagée dans l’action et tendue vers l’absolu. Weil elle-même écrivait : « Quoiqu’il me soit plusieurs fois arrivé de franchir un seuil, je ne me rappelle pas un moment où j’aie changé de direction ».
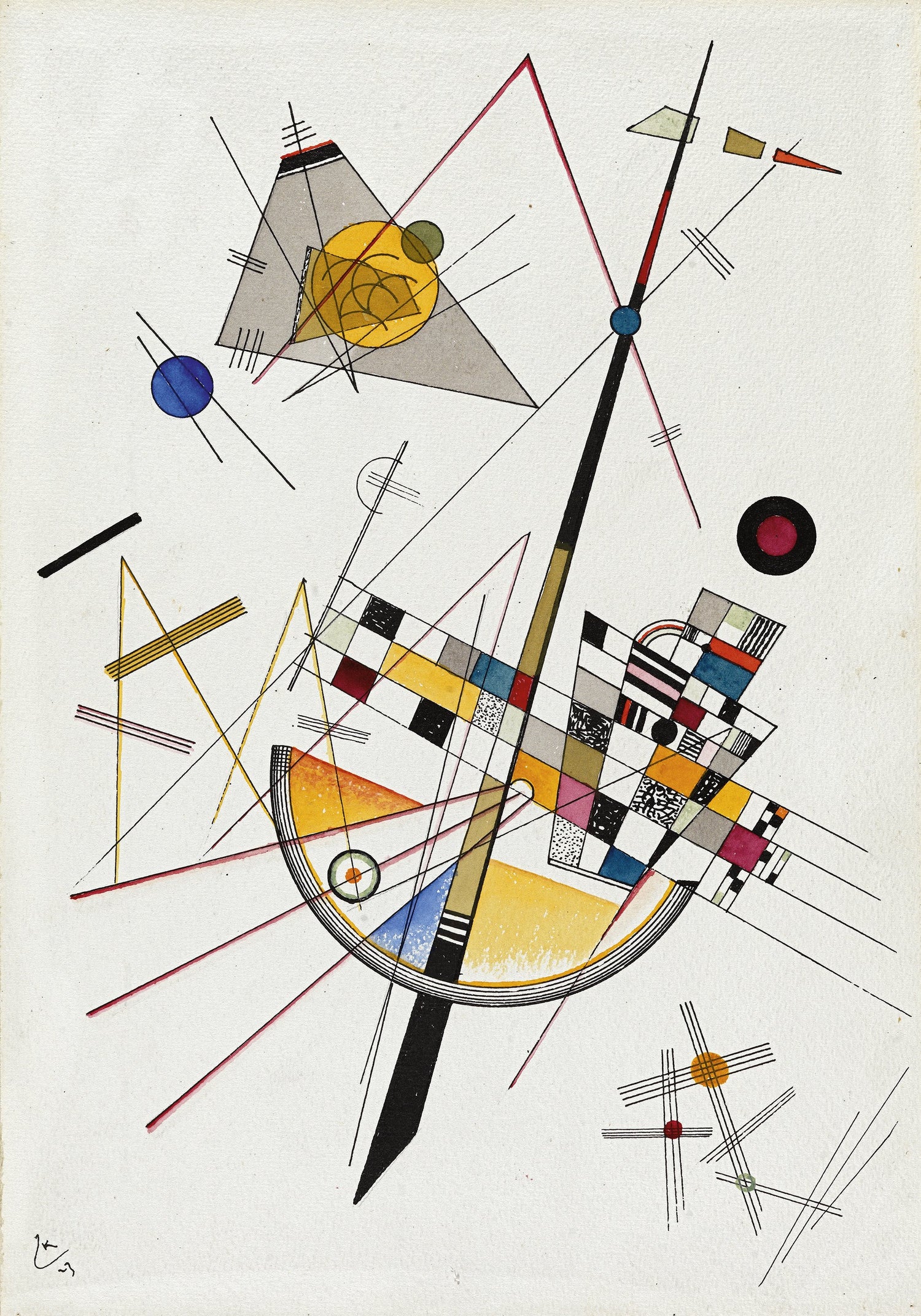
De 20h à 21h15, 16.10 / 04.12 / 18.12 / 15.01 / 19.02 / 19.03 / 16.04 / 21.05 / 18.06
La disparition des arts par Dimitri Ghantous
« L’art est mort », déclare Hegel en 1830 : il n’est plus dépositaire de l’absolu, confié désormais à la philosophie, la science et la politique. Paradoxe : c’est après cette date que naissent nos avant-gardes, de Baudelaire à Duchamp, de Cézanne à Debord. Un siècle et demi plus tard, Sollers diagnostique leur crise et la fin de l’espace marxo-psychanalytique qui les portait.
Aujourd’hui, dans une société où l’art devient divertissement, marchandise ou luxe, la question se repose : disparition ou transformation de sa puissance ? Ce groupe d’étude théorique suivra les échos de la formule de Hegel et ses résonances, de la fin des avant-gardes aux formes contemporaines du spectaculaire et du marché.
« Introduction à la pensée de Simone Weil » – Alice Mennesson
De 19h à 20h30, 07.10 / 04.11 / 10.12 / 27.01 / 10.03 / 05.05 / 02.06
Nous proposerons un itinéraire dans la pensée de Simone Weil, des premiers écrits de khâgne à l’Enracinement. Comment aborder une pensée en apparence si variée tant par ses formes d’expression que par ses objets ? Quel rapport entre les réflexions sur l’art d’une jeune élève d’Alain, les articles contre le colonialisme, les notes méthodiques du Journal d’usine, le projet de formation d’une unité militaire d’infirmières de première ligne ou les textes des dernières années sur le malheur des hommes et l’amour de Dieu ?
À travers l’étude de quelques textes majeurs reflétant la variété des formes de son engagement dans l’action et dans la pensée, nous nous efforcerons d’interroger et d'entendre ce qu’elle disait d’elle-même : "Quoiqu'il me soit plusieurs fois arrivé de franchir un seuil, je ne me rappelle pas un moment où j'aie changé de direction ».
